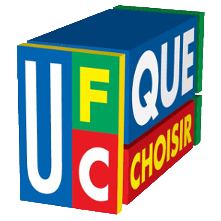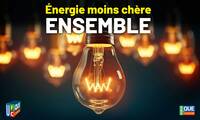Pour bon nombre de Français, notamment les étudiants et ceux démarrant leur vie professionnelle, se loger constitue un vrai défi. Dans certaines grandes villes (Paris, Toulouse, Rennes…), le long du littoral atlantique ou dans les régions frontalières, louer un bien relève même du parcours du combattant. Et il est tout aussi difficile de devenir propriétaire de sa résidence principale (comme 6 ménages sur 10, selon l’Insee), au regard du coût du crédit – bien qu’il baisse un peu depuis quelques mois – ou des prix au mètre carré. Alors, si vos enfants cherchent un toit, quelle meilleure solution que l’entraide familiale ? Mais attention ! S’il existe de multiples façons de leur donner un coup de pouce salvateur, il faut faire les choses dans les règles pour éviter toutes querelles fratricides ou des regards trop insistants de l’administration fiscale. Voici 7 solutions potentiellement faciles à mettre en œuvre.
1. Avancer des fonds pour un achat immobilier
Établir un contrat de prêt avec ses enfants afin qu’ils financent plus aisément l’acquisition d’un bien est monnaie courante. Reste que cela nécessite de disposer de suffisamment de liquidités, de surcroît facilement mobilisables.
Principe C’est extrêmement simple : vous ou toute autre personne (une tante, un oncle…) acceptez de mettre à la disposition de votre enfant une certaine somme, qui sera remboursable selon des modalités de restitution (échéances, taux, durée du prêt…) fixées conjointement. Les deux parents peuvent décider ensemble ou séparément d’une telle avance familiale, laquelle ne comporte aucune limite de montant. Il est possible de réaliser cette opération sous seing privé, mais l’aide d’un notaire est conseillée si le prêt s’avère important.
Formalités Un contrat en deux exemplaires doit être établi. La réglementation l’exige d’ailleurs si le prêt est égal ou supérieur à 1 500 € (décret n° 80-533 et art. 1359 du Code civil). En outre, si ce montant (ou la somme de plusieurs prêts familiaux accordés au cours de la même année civile) excède 5 000 €, vous et votre enfant êtes tenus, chacun de votre côté, d’en informer l’administration fiscale au moment de votre déclaration de revenus – soit en 2026 pour un prêt conclu cette année. À défaut, vous êtes passible d’une amende de 150 €. Si vous la faites sur papier, vous aurez à remplir le formulaire 2062 ou Cerfa n° 10142. Cependant, dans le cas où vous sollicitez un notaire, c’est lui qui se chargera de déclarer le prêt. Par ailleurs, en tant que prêteur, vous devez indiquer chaque année les intérêts perçus sur vos capitaux mobiliers (formulaire 2042).
Précautions à prendre Un taux d’intérêt fixé librement (symbolique ou alors inférieur aux taux pratiqués par les banques) et un échéancier de remboursement font toujours partie du contrat de prêt. Votre enfant, lui, doit réellement rembourser l’avance de fonds – de façon régulière, comme pour un prêt amortissable classique, ou en une fois au terme du contrat s’il s’agit d’un prêt in fine. Tandis que de votre côté, il faut garder les preuves de ces versements (relevés de compte, photocopie des chèques…). Attention ! Contrairement à une idée reçue, la somme prêtée « constitue une charge comme une autre, qui sera comptabilisée par les banques pour évaluer le taux d’endettement du candidat à l’emprunt », souligne Ludovic Huzieux, cofondateur d’Artémis Courtage.
Risques Si votre enfant ne vous rembourse que partiellement, voire pas du tout, le fisc peut estimer qu’il s’agit d’une donation déguisée (surtout pour des montants élevés), ce qui vous expose à diverses pénalités (intérêts de retard…). De leur côté, les frères et sœurs n’ayant pas bénéficié d’un tel avantage sont en droit de réclamer sa prise en compte au moment de votre succession (y compris si elle intervient plus de 15 ans après la date du prêt), avec les risques de réévaluation de la somme prêtée au prorata de sa quote-part, au jour de votre décès, dans le financement du logement. Pour éviter d’en arriver à un tel scénario, « il est possible à tout moment de transformer ce prêt en abandon de créance, c’est-à-dire en donation ou, mieux encore, en donation-partage au profit de tous les enfants, ce qui fige la somme », souligne Karine Duvernier, notaire à Arras (62) et membre du Groupe Monassier.
2. Donner de l’argent avec ou sans condition d’emploi

Les dons manuels d’argent ont l’avantage de la simplicité, puisqu’un virement suffit à les matérialiser. En outre, les montants qu’il est aujourd’hui possible de transmettre sont particulièrement importants.
Principe Trois dispositifs sont mobilisables pour donner un coup de pouce à un enfant qui souhaite acheter. Le premier, de loin le plus simple, est le don familial, exonéré de droits à hauteur de 31 865 € par parent et par enfant (63 730 € pour un couple). Le deuxième consiste en une donation, libérée de droits elle aussi dès lors qu’elle n’excède pas 100 000 € par parent et par enfant (200 000 € pour un couple). À noter : ces deux opérations sont renouvelables tous les 15 ans, sans taxes à payer. Le troisième dispositif, très récent, est applicable depuis le 15 février et jusqu’au 31 décembre 2026. C’est également un don d’argent, qui vient s’additionner aux deux précédents, à hauteur de 100 000 € par donateur (père, mère, grands-parents, et aussi oncles ou tantes, à condition qu’ils n’aient pas eux-mêmes de descendants, et uniquement pour les enfants de leurs propres frères et sœurs), dans la limite de 300 000 € par donataire (bénéficiaire du don).
Formalités Quelle qu’en soit la forme, le don manuel n’impose pas forcément de recourir à un notaire, mais il est obligatoire de le déclarer au fisc. Et c’est à votre enfant qu’il revient de le faire – en ligne ou via le formulaire 2735-SD – dans un délai de 30 jours après réception. Si vous avez plusieurs enfants, et que « vous ne pouvez pas les gratifier tous en même temps des mêmes montants », passer par le notaire est judicieux. De fait, « il faut avoir conscience d’effectuer soit une donation en avancement de part successorale, qui nécessitera un rappel civil au moment de votre succession, soit une donation hors part successorale », note Me Karine Duvernier, notaire à Arras.
Précautions à prendre À la différence du don familial et de la donation classique, le don supplémentaire de 100 000 €, possible donc jusqu’à fin 2026, doit être fléché, dans les six mois suivant son versement, vers l’acquisition d’un logement neuf (ou en l’état futur d’achèvement) servant de résidence principale au donataire (ou à un locataire, hors membres de la famille) durant au moins cinq ans. Il peut aussi être utilisé pour des travaux de rénovation éligibles à MaPrimeRénov’ dans une résidence principale.
Risques Un don d’argent simplement déclaré ne peut pas comporter de conditions d’emploi (un achat immobilier obligatoire ou une interdiction de mise en communauté du logement, par exemple), à l’inverse d’un don formalisé par un acte authentique. Par ailleurs, en ce qui concerne le don temporaire affecté à une résidence principale neuve, si la condition d’occupation de cinq ans n’est pas respectée, des droits de donation peuvent être calculés rétroactivement par le fisc.
3. Louer un bien à un proche
À condition d’être anticipée, cette solution peut s’avérer pertinente. Elle exige cependant de savoir dissocier bons sentiments et finances…
Principe Il est possible de donner congé à un locataire si l’on justifie, en tant que bailleur, « du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise » du logement (art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Sous réserve de tout faire dans les règles (préavis envoyé au moins six mois avant la fin du bail pour un bien non meublé, mention du nom, de l’adresse et du lien de parenté du bénéficiaire de la reprise…), rien ne s’oppose donc à ce qu’un parent récupère un bien pour y loger son enfant (ou un descendant). Mieux : si ce logement a été acquis dans le cadre du dispositif Pinel, il peut lui louer sans remise en cause de la réduction d’impôt, dès lors que l’enfant n’est plus rattaché à son foyer fiscal et a des revenus inférieurs aux plafonds applicables.
Formalités Mis à part la rédaction d’un bail en bonne et due forme, elles sont réduites au minimum.
Précautions à prendre « Quand on loue à un proche, il est tentant de le faire à un prix bien inférieur à ce qu’il devrait être, d’autant qu’en percevant moins de loyers, on paye moins d’impôts », indique Emmanuel Narrat, dirigeant fondateur d’Haussmann Patrimoine. Toutefois, on risque alors le redressement ! Pour l’éviter, il faut « pratiquer un loyer identique à celui que l’on demanderait à un tiers, ou s’appuyer sur l’avis d’une agence immobilière. À défaut, on trouvera des petites annonces avec des loyers comparables afin de prouver, le cas échéant, qu’on n’est pas hors marché ». Dans le même esprit, établir des quittances de loyers et conserver la trace des versements est impératif.
Risques Ils sont du côté du fisc, qui « peut estimer que les revenus fonciers perçus par les parents ne correspondent pas à la valeur locative réelle du bien, explique Frédéric Logeart, notaire à Reims (51), membre du Groupe Monassier. Il est alors en droit de les redresser à hauteur des montants de loyers qu’il estime non perçus, voire de leur appliquer des pénalités de 40 % sur les revenus soustraits à l’impôt. » De même, s’il y a déduction de charges (travaux de copropriété, intérêts d’emprunt…) créant un déficit foncier, « l’administration fiscale sera très regardante, et n’hésitera pas à sanctionner les propriétaires ayant minoré le loyer », assure Stéphane Jacquin, responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Lazard Frères Gestion.
4. Offrir un logement que l’on possède

Pour effacer une plus-value taxable, il peut être judicieux de donner un bien, quitte à ce que l’enfant qui en profite le revende aussitôt après.
Principe Ce mécanisme permet d’effacer l’impôt à payer sur la plus-value immobilière et, pour les personnes assujetties à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), de sortir ce bien de leur patrimoine taxable.
Formalités Toute donation d’un bien immobilier (ou d’un terrain) exige de recourir à un notaire. Même s’il s’agit d’un bien propre à un seul des deux parents (car reçu en héritage, par exemple), l’abattement de 100 000 € par enfant et par parent joue deux fois, ce qui est loin d’être négligeable. De plus, les droits dus au-delà de 200 000 € bénéficient deux fois des tranches les plus basses du barème progressif des droits de donation.
Précautions à prendre Il est possible d’insérer, dans l’acte de donation, des conditions telles qu’une interdiction de mise en communauté du bien donné, ce qui évitera, en cas de décès de votre enfant ou de changement matrimonial ultérieur, la transmission du bien à son conjoint ou partenaire de pacs (cette interdiction joue tant que les donateurs sont en vie, mais pas après leur décès).
Risques Ils se situent du côté des autres enfants, puisqu’une donation (sauf si elle est effectuée « hors part successorale », ce qui permet d’avantager un enfant par rapport aux autres) est rapportable à votre succession. Le donataire peut alors avoir à verser une indemnité de rapport, calculée sur la base de la valeur du bien (s’il l’a encore) au jour de votre décès, et non sur la base de la valeur transmise.
5. Vendre un de ses biens immobiliers
Pour qu’elle soit parfaitement incontestable, cette opération ne doit pas être « hors sol ». D’où l’importance de fixer le juste prix du bien.
Principe Plutôt que de vendre un de vos biens à une personne tierce, vous le cédez à un de vos enfants. Rien ne vous empêche, préalablement, de lui faire un don d’argent, surtout si vous n’avez pas utilisé les abattements de 31 865 € et de 100 000 € au cours des 15 années précédentes.
Formalités Toute cession d’un bien immobilier, y compris à l’un de vos enfants, se fait obligatoirement avec l’aide d’un notaire.
Précautions à prendre Si le prix de vente peut ne pas se situer dans la fourchette haute du marché, il doit impérativement être en corrélation avec la réalité. Il n’est pas question, par conséquent, de vendre à un prix particulièrement décoté.
Risques Au mieux, un prix sous-évalué expose l’enfant acheteur à un recalcul, par l’administration fiscale, des droits de vente sur la base d’une valeur vénale réelle. Mais au pire, elle pourrait considérer qu’il s’agit là d’une donation déguisée et la taxer comme telle ! Sans oublier les frères et sœurs qui sont susceptibles de réagir au moment de votre succession, arguant qu’un tel achat à prix « cassé » s’apparente à une donation et doit être rapporté dans la succession.
6. Mettre à disposition un logement gratuitement
Voici une solution très intéressante pour les personnes dont le patrimoine immobilier est important ou qui sont fortement fiscalisées.
Principe Il s’agit de céder à un enfant la jouissance gratuite d’un logement pour une durée déterminée (en ayant respecté un préavis de six mois auprès du locataire en place), tout en conservant la nue-propriété. Il est aussi possible, et parfois même préférable, de lui céder les loyers encaissés afin de l’aider à se payer une location ou à rembourser un emprunt immobilier. Ce mécanisme de donation temporaire d’usufruit a des avantages fiscaux non négligeables. Dans le premier cas, vous êtes en mesure de sortir de votre base d’imposition la valeur en pleine propriété de ce logement – ce qui peut vous permettre de ne plus payer l’impôt sur la fortune immobilière si vous y êtes assujetti. Dans le second cas, « plutôt que de percevoir des loyers qui seront évidemment fiscalisés, puis de donner cet argent à un enfant et d’être potentiellement taxé sur ce don, cela a du sens de transmettre directement les loyers encaissés, le temps des études notamment, car cela diminue votre imposition à la fiscalité immobilière », souligne Emmanuel Narrat, dirigeant d’Haussmann Patrimoine.
Formalités Cet acte nécessite un notaire, car des droits de donation sont à payer. Ils représentent 23 % de la valeur en pleine propriété du logement par période de 10 ans (art. 669 du Code général des impôts), quel que soit votre âge ou celui de l’usufruitier, « y compris si l’usufruit dure moins longtemps », fait remarquer Stéphane Jacquin, du cabinet Lazard Frères Gestion. Pour un bien valant 200 000 €, ils s’élèvent donc à 46 000 € (200 000 € x 23 %), mais si vous n’avez pas « utilisé » l’abattement dédié aux donations entre parent et enfant, qui se reconstitue tous les 15 ans et se monte actuellement à 100 000 €, vous en serez exonéré. Seul le coût de l’acte notarié sera à votre charge (de 1 000 à 2 000 € TTC).
Précautions à prendre « La convention de prêt à usage, ou commodat, consentie par des parents au profit d’un de leurs enfants, devra, par exemple, préciser qu’il s’agit d’une modalité d’exécution de leur obligation d’entretien ; l’échéance de restitution devra être indiquée, et la faculté de sous-location exclue afin d’éviter la requalification en donation. C’est une manière de désamorcer une bombe au moment de la succession », insiste Me Frédéric Logeart, membre du Groupe Monassier Reims.
Risques Il est tout à fait courant de prêter un logement à un enfant sans contrepartie financière ni acte notarié en ce sens (nettement moins de lui rétrocéder tout ou partie des loyers sans recourir aux services d’un notaire). Cependant, faute de loyers perçus, vous ne serez plus en mesure de déduire, le cas échéant, les charges supportées pour ce bien (travaux, intérêts d’emprunt…). Ce qui n’est d’ailleurs pas le plus grave. En effet, si la mise à disposition gratuite dure plusieurs années, « un risque de requalification en donation existe. Il s’avère alors judicieux de traiter celle-ci du vivant des parents, par réincorporation dans le cadre d’une donation-partage. Le but est de rétablir l’équilibre, toujours souhaitable, entre tous les enfants », souligne Me Frédéric Logeart.
7. Acheter ensemble mais en démembrant
Cette technique permet de minorer ou d’effacer les droits de donation. Elle est d’autant plus judicieuse que les parents sont encore jeunes.
Principe Les parents et leur enfant achètent le bien ensemble en démembrement. L’enfant acquiert directement la nue-propriété et ses parents ont l’usufruit, « sachant qu’ils peuvent tout à fait décider de ne pas utiliser ni de louer le bien, et de le laisser à la disposition de leur enfant sans que l’administration fiscale ait à y redire », détaille Me Frédéric Logeart, notaire à Reims.
Formalités Le recours à un notaire est obligatoire pour formaliser l’achat.
Précautions à prendre L’opération peut être optimisée en étant précédée, au profit de votre enfant, d’une donation à hauteur de 100 000 € et d’un don familial de 31 865 €, tous deux totalement exonérés de droits. « Par rapport à un achat en pleine propriété, acquérir la seule nue-propriété et en avoir un usage immédiat, avec l’accord du ou des usufruitiers, permet de viser un logement plus grand. Ce mécanisme a un effet de levier puissant », indique Me Frédéric Logeart. Par ailleurs, l’enfant nu-propriétaire et les parents usufruitiers doivent financer les frais d’acte notarié à hauteur de leurs droits respectifs.
Risques Si l’enfant nu-propriétaire ne paye pas les frais d’acte à hauteur de ses droits, le fisc peut considérer qu’ils ont été réglés par ses parents, et donc requalifier l’opération en donation et appliquer des taxes.
Céder ses droits à prêt – Bonne ou mauvaise idée ?
Un Français sur sept détient actuellement un plan épargne logement (PEL) (1). Si vous êtes concerné, faut-il céder à votre enfant vos droits à prêt, comme la réglementation l’autorise en cas de plan de plus de trois ans ? La réponse est nuancée… Certes, cette opération lui permettra d’obtenir un meilleur crédit (montant plus élevé ou durée plus longue), surtout si le PEL a été ouvert entre le 1er février 2016 et le 31 décembre 2022, avec un taux particulièrement compétitif de 2,7 ou 2,2 % l’an, hors assurances. Mais, de votre côté, mesurez l’opportunité de ce transfert à l’aune des intérêts que vous pouvez percevoir chaque année : 3,27 % par an hors prime d’État, pour un plan ouvert avant le 31 juillet 2003, par exemple. Et même davantage pour les générations plus anciennes !
(1) Selon le rapport annuel de la Banque de France sur l’épargne réglementée 2023, publié en juillet 2024.
Les aides auxquelles on ne pense pas toujours
Afin d’aider son enfant à décrocher une location agréable et bien isolée, il est possible de se porter caution solidaire de ses loyers et charges, « ce qui confère au bailleur une garantie supplémentaire et peut faire la différence quand il s’agit de départager plusieurs bons dossiers », indique Emmanuel Narrat, d’Haussmann Patrimoine. Vous pouvez aussi signer le bail à sa place, mais cela le privera, entre autres, de l’aide personnalisée au logement. S’il est dans le besoin et n’est plus rattaché à votre foyer fiscal, vous avez le droit de lui verser une pension alimentaire et de la déduire de votre revenu global (6 807 € maximum pour 2024). Autre solution : lui permettre, à travers une SCI familiale, de décrocher un crédit et de devenir propriétaire.
Roselyne Poznanski